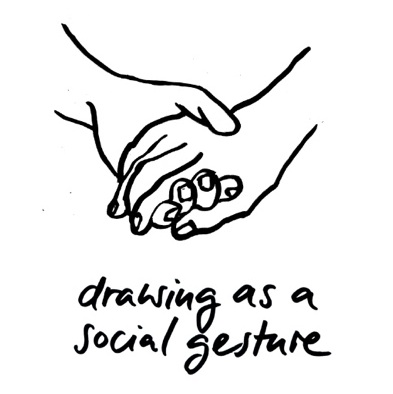
Drawing as a social gesture / Le dessin comme geste social
Les évolutions des théories et des pratiques du dessin au prisme de l’ethnicité, de la classe et du genre
Colloque international organisé par Marine Schütz et Katrin Ströbel
mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 novembre 2025 au FRAC Picardie et à la Galerie Totem
Depuis une vingtaine d’années, les usages du dessin témoignent du fait que ce médium nous permet « de réfléchir sur le monde et de nous y engager activement » (Rebecca Fortnum 2021). À même de provoquer des changements, en commençant par la manière dont les artistes choisissent de répondre à leurs expériences et à leurs environnements, ce dispositif familier et léger, poreux aux technologies visuelles comme à la pensée, est de plus en plus utilisé comme un catalyseur dans le cadre d’action collectives. De plus, la prise en compte des paramètres de l’ethnicité, de la classe et du genre permet de sonder l’évolution des pratiques et des théories du dessin. En effet, les outils des postcolonial studies, des cultural studies et des études de genre mettent au jour la façon dont les sujets peuvent, par leur « positionnalité » même (Pollock), transformer le monde social, au prisme des nouveaux rapports de force qu’ils et elles font valoir en déstabilisant – notamment par des savoirs graphiques situés – les politiques de représentation établies.
Concernant les conditions qui ont conduit à l’expérimentation, par les artistes, du dessin comme geste social, figure certainement l’évolution des dispositifs d’enseignement du dessin qui, en laissant de côté la normativité technique, ont ouvert le champ aux identity politics comme aux cultures visuelles. La reconnaissance des ressources propres au dessin, que sont son « indétermination » (Karen Kurczynski 2014) et sa « dimension relationnelle » contribuent en outre à expliquer le déploiement des questions sociales dans le dessin, dont les frontières deviennent de plus en plus poreuses, quand ses gestes ou ses espaces recoupent ceux de la performance ou de l’installation.
Ce colloque a pour ambition d’étudier les relations entre le dessin et le champ social à partir de paroles, d’actions d’artistes, d’études de cas de élaborées par des chercheur.e.s et d’un workshop. Les communications permettront de saisir les modalités selon lesquelles les artistes peuvent, et ont pu explorer, les pratiques graphiques pour inverser les rapports de force qu’impliquent la normativité du champ social et les représentations dominantes (mémorielles ou politiques par exemple) et faire communauté. Certaines interventions étudient les fonctions singulières qui émergent, du dessin comme mémoire ou contre-écriture, révélant la façon dont ces usages sont déterminés par les intérêts de communautés spécifiques – notamment LGBTQIA+, diasporiques, féministes, militantes-. D’autres sondent la question du dessin comme geste social en interprétant la teneur de ce croisement sur le plan de l’évolution des définitions de l’acte graphique, témoignant de la remise en cause de ses conditions classiques quand il devient collectif. Le colloque international fait suite à un premier opus tenu les 4 et 5 décembre 2024 à la Staatliche Akademie der Bildenden Künste de Stuttgart.