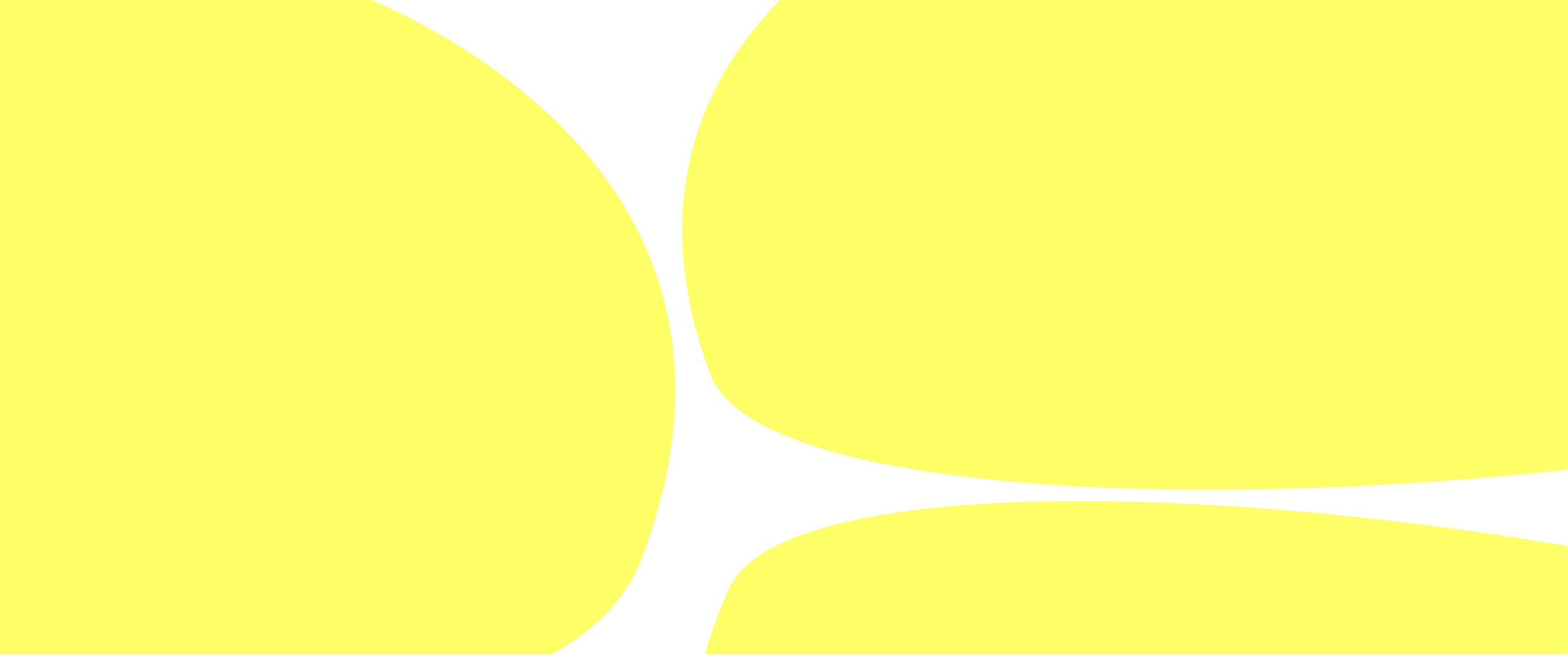
Les corps de l’art
Séminaire de recherche de l’axe 4 : « Temporalité, lumière, mouvement »
Depuis les années 1950, la théorisation de la réception des œuvres d’art a donné lieu à de nombreuses approches disciplinaires, s’appuyant notamment sur les sciences humaines pour envisager ses différents aspects. Peu à peu, la dimension corporelle de l’expérience spectatorielle est devenue un enjeu de réflexion dans les divers domaines artistiques, obligeant à dépasser la réduction des œuvres d’art, opérée par la sémiologie, à un réseau de signes s’adressant à la seule faculté intellectuelle de décodage et de compréhension. Alors que l’application de la psychanalyse à la théorisation de l’art a mis en valeur la dimension pulsionnelle et jouissive du rapport aux œuvres, l’esthétique s’est préoccupée du caractère sensible de la réception spectatorielle. La phénoménologie a approfondi son analyse de l’engagement corporel de notre rapport au monde, et aux œuvres, notamment dans le cadre des embodied spectatorship studies anglo-saxonnes qui se sont développées à partir des années 1990, tandis qu’en France, Raymond Bellour livrait dans le champ des études cinématographiques un ouvrage fondamental sur le sujet, Le Corps du cinéma (2008). Les études féministes, quant à elles, ouvrirent la voie, dans les années 1970, à la prise en compte de la situation particulière de la réceptrice, à partir d’une différenciation genrée, puis raciale, tout en mettant en évidence la prégnance de l’aspect haptique des œuvres issues de créatrices. Même le cognitivisme a connu, dans les années 1990, un tournant par lequel il a dépassé son approche initiale, restreinte aux processus de compréhension rationnels, pour prendre en compte les émotions que les œuvres provoquent.
Le spectateur, la spectatrice, ont un corps, qu’ils n’abandonnent pas quand ils entrent dans une salle de cinéma ou de théâtre, ou qu’ils considèrent un tableau ou une sculpture dans une exposition. Les artistes contemporains et actuels ont fait de cette dimension corporelle un enjeu. Les films, et les salles dans lesquelles les oeuvres sont montrées sont de plus en plus immersifs, les installations de l’art contemporain engendrent des parcours à l’intérieur même de l’œuvre où la mobilité physique fait partie intégrante de l’appréciation de ce qui est proposé, l’interaction revendiquée par les happenings, les performances, puis par l’esthétique relationnelle, propose des contacts de plus en plus étroits entre artistes, œuvres et récepteurs, qui mettent en jeu tous les sens. Certaines œuvres se donnent elles-mêmes comme des corps, spatialisées et sujet au passage du temps. À l’état gazeux, l’art ne se cantonne plus à une présentation face-à-face, il nous englobe intégralement dans une ambiance diffuse. Aujourd’hui, soumises aux technologiques numériques et mises au défi par l’intelligence artificielle, nos expériences physiques et sociales mutent à une vitesse vertigineuse et invitent les artistes à interroger nos pratiques de l’espace et de l’Autre, cherchant à ré-inventer des expériences sensibles à partager.
Le corps des récepteurs, mais aussi le corps des œuvres, et celui des artistes, face à la matière qu’ils façonnent et avec laquelle ils travaillent, quelle qu’elle soit concrète, mais aussi virtuelle, humaine. Ce séminaire entend aborder toutes ces dimensions, dans l’idée que le rapport à l’art peut difficilement se penser en dehors d’un corps-à-corps entre récepteurs, œuvres et créateurs. Comment penser la réception sensible, physique, de l’art, en tenant compte des divers dispositifs qui l’encadrent (musées, galeries, salles de cinéma ou de théâtre, dans leurs formes les plus actuelles) ? Comment envisager la corporalité des œuvres, leur capacité d’agir et d’engendrer des réactions physiques à leurs mouvements internes ? Comment conceptualiser la dimension physique de la création artistique, des gestes de l’artiste face à son œuvre, à la relation entre un metteur en scène ou un chef d’orchestre aux corps qu’il dirige (acteurs, danseurs, musiciens), sans oublier l’interrelation entre les corps des interprètes ? Quelles sont les parts des données physiologiques et du contexte socio-culturel dans notre relation corporelle aux œuvres ? Comment penser la dimension organique des œuvres elles-mêmes ? Ces questions concernent tous les arts (arts plastiques, arts appliqués, design, cinéma, théâtre, musique, danse, etc.). Mais leurs spécificités, qui n’excluent pas les croisements et l’interdisciplinarité, engagent à des études dont la réunion au sein de ce séminaire sera profitable pour une étude comparée des corps de l’art.
Elisabeth Piot & Emmanuel Plasseraud
PROGRAMME 25-26
JEUDI 4 DECEMBRE 18h-20h00 – AUDITORIUM – UFR Arts-UPJV
Oriane Sidre, Docteure en études cinématographique
Oriane Sidre est docteure en études cinématographiques et enseigne à l’Université de Picardie-Jules Verne d’Amiens. Sa thèse portait sur les adaptations animées des histoires de Kenji Miyazawa, avec une approche à la fois transmédiatique et esthétique. Elle effectue des recherches sur l’animation, le cinéma japonais, les transferts entre les textes et les images animées.
JEUDI 26 MARS 18h-19H30 – AUDITORIUM – UFR Arts-UPJV
Clio Simon, artiste réalisatrice
Clio Simon, née en 1984, vit et travaille à Lille. « Naviguant entre les champs du cinéma et de l’art contemporain, elle s’intéresse aux relations que l’image entretient avec le langage et le silence. Elle travaille avec le réel à la recherche d’une énergie politique, sans négliger des chemins possibles vers la fiction. Sa pratique qui se veut pluridisciplinaire lui permet de construire des équipes avec des profils variés (chercheurs, scientifiques, anthropologues, compositeurs). » https://www.le-bal.fr/biographies/clio-simon
Clio Simon travaille actuellement à un projet de création d’une installation-vidéo live à destination des salles de cinéma intitulé Plaidoyer pour le temps présent. L’œuvre se situe en regard du plaidoyer de l’historien et politologue Achille Mbembe rédigé en avril 2020 pour le droit universel à la respiration que l’artiste associe aux propos de Marie-José Mondzain, philosophe, pour qui : « La véritable urgence est bien pour nous le combat contre la confiscation des mots, des images et du temps. »
JEUDI 5 FEVRIER 18h-19H30 – AUDITORIUM – UFR Arts-UPJV
Marion Bocquet-Appel, artiste céramiste
Marion Bocquet-Appel vit et travaille à Paris, à Ivry-sur-Seine, Bruxelles. Elle est actuellement engagée dans une thèse de recherche et création sous la direction de Eric Van Essche et Caroline Andrin – Ecole Nationale Supérieure des Arts Visuels de La Cambre – département céramique et Université Libre de Belgique et le laboratoire de recherche GRESAC
« Au travers de pièces et d’installations, le travail de Marion Bocquet-Appel, artiste céramiste, se présente sous deux registres : celui de l’objet, et celui de sa situation. Imprégnant ses oeuvres des territoires traversés pour l’acquisition des savoirs-faire propres à les produire, l’artiste s’écarte de ces références au moment de les combiner. Contre tout géocentrisme, l’aphorisme plane : trop loin à l’ouest, c’est l’est. De même que matière et technique sont métonymiques des objets produits – céramique, grès, faïence, porcelaine – au-delà de l’ambiguïté entre artisanat et arts plastiques, la disposition des oeuvres au sein non de territoires mais de systèmes de confrontation ou de sérialité, en hybridation avec les nouveaux médias, les extrait de tout soupçon de fonctionnalité. » Audrey Teischamn