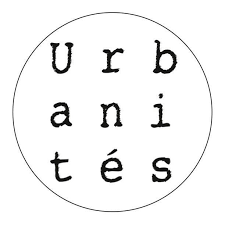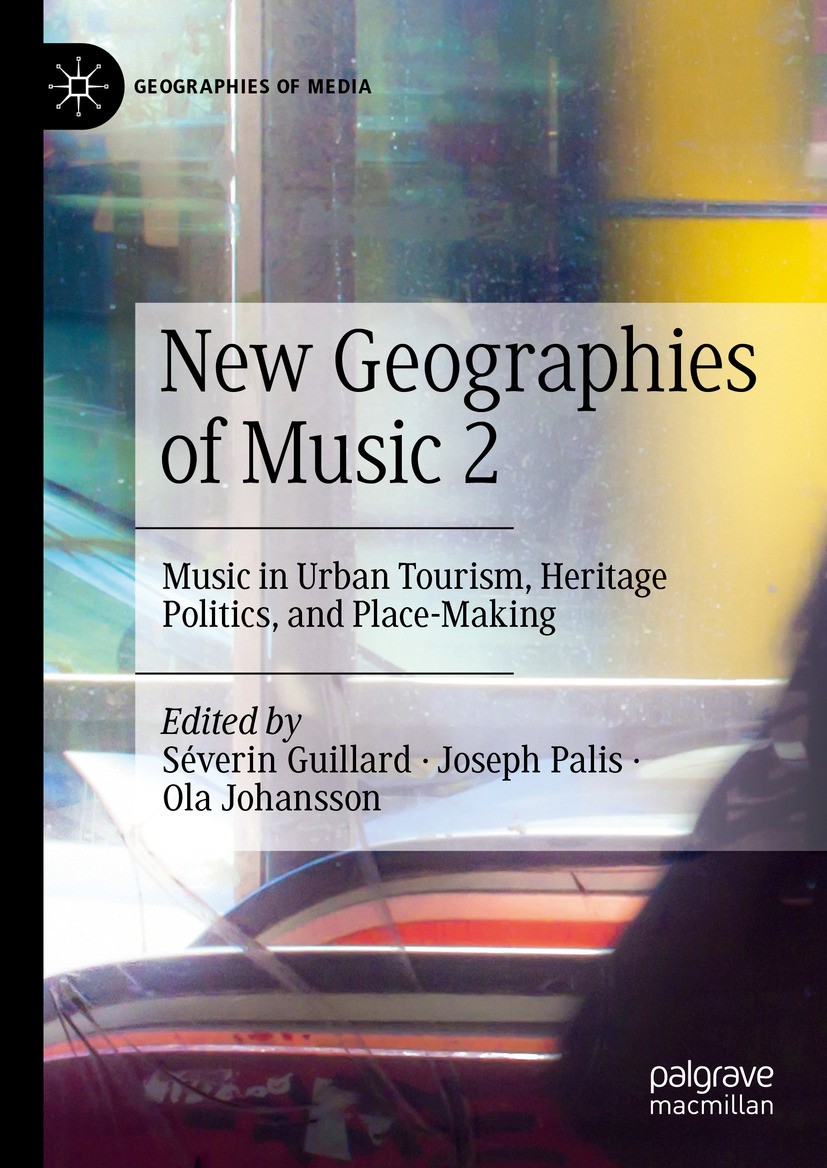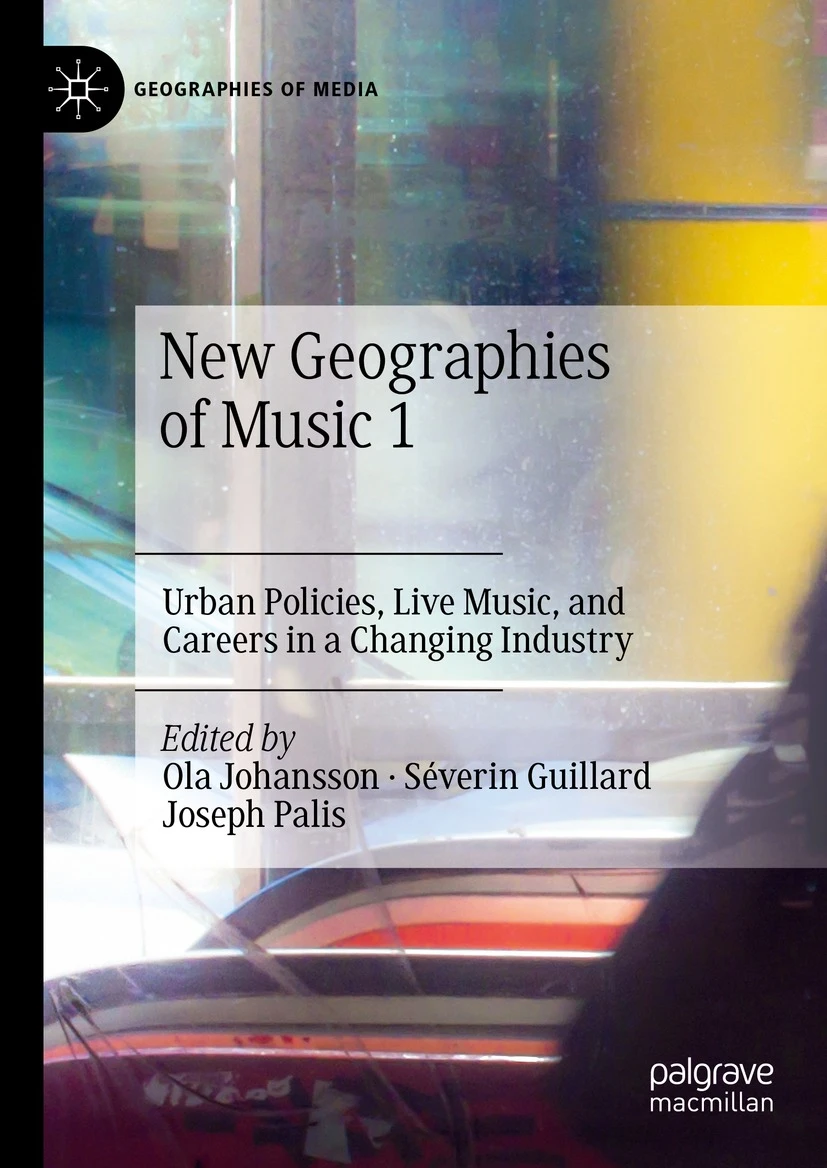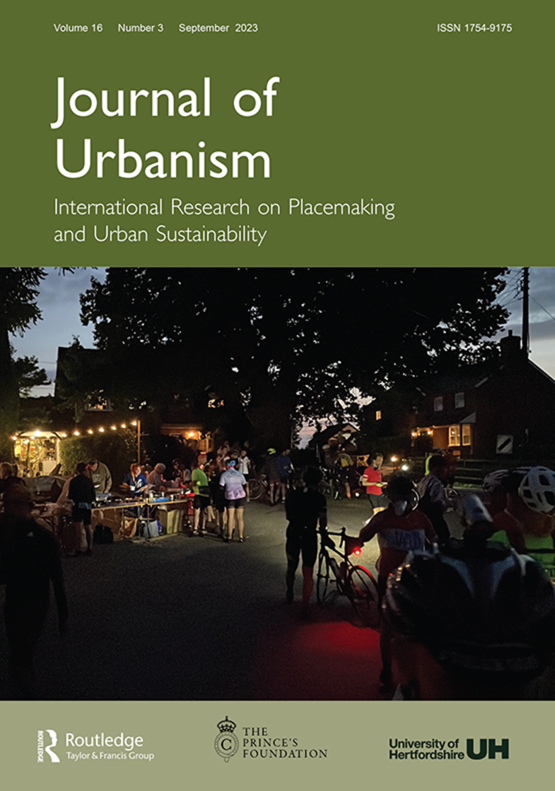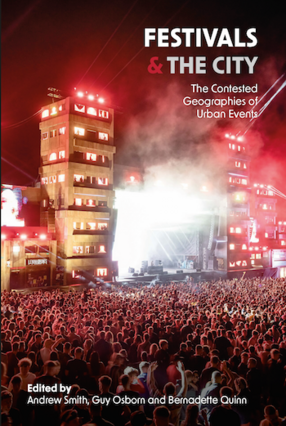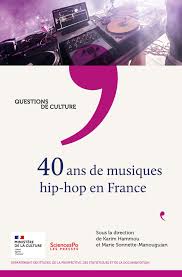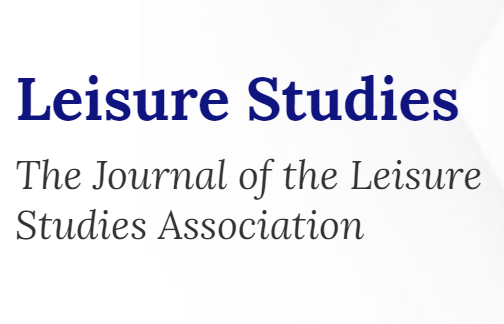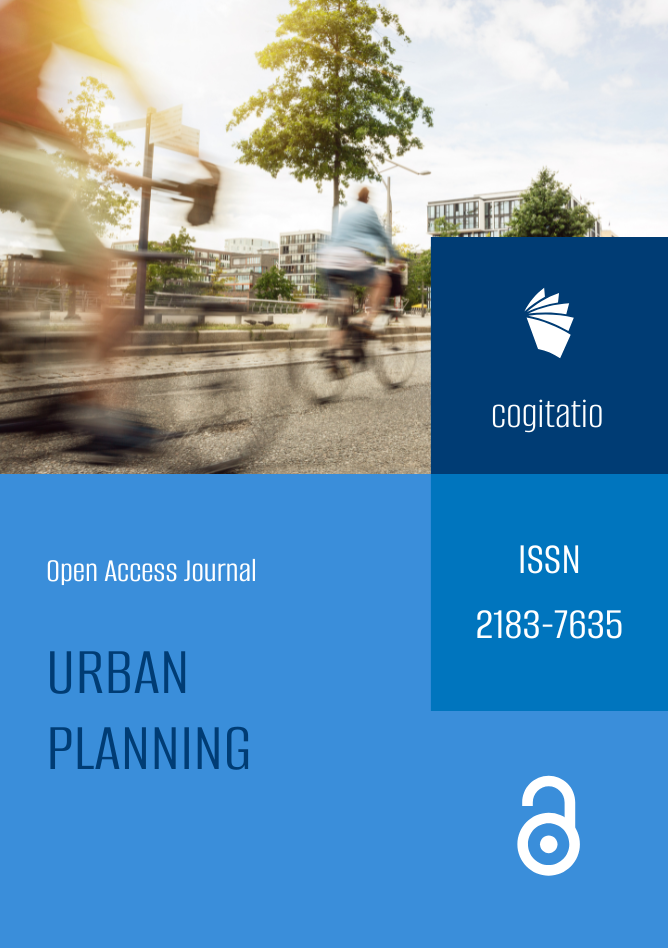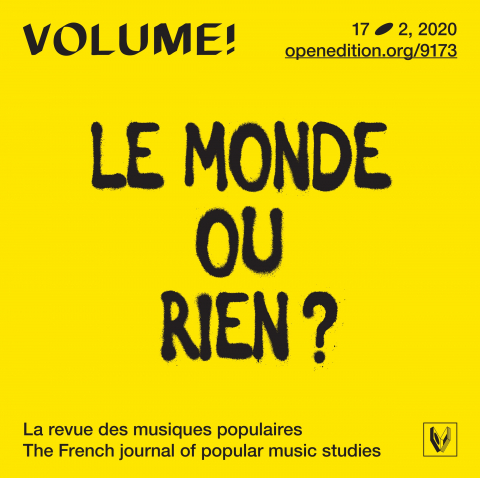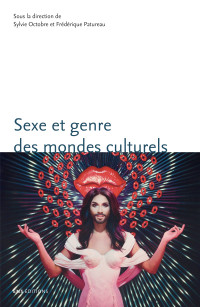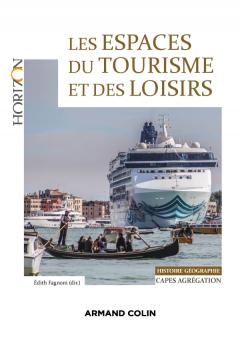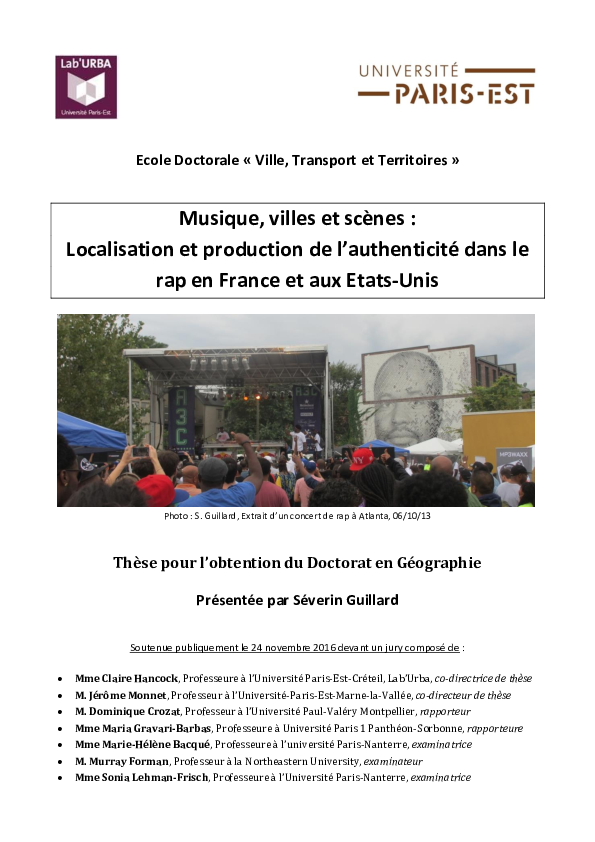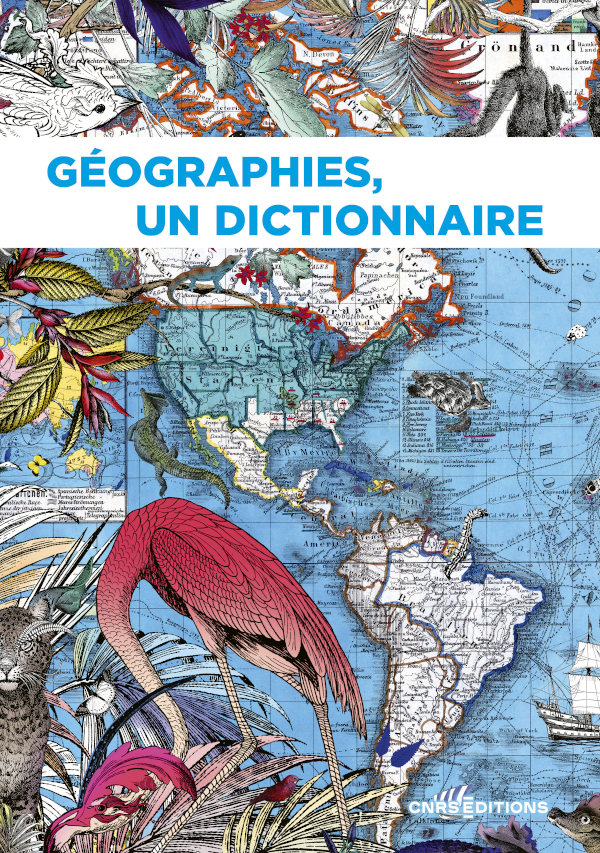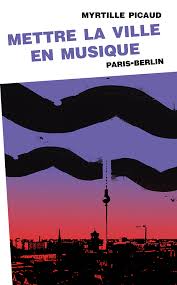Séverin Guillard
- Biographie
- Projets
- Articles
- Ouvrages
- Communications
- Médias
- Autres
Séverin Guillard est Maître de Conférences en géographie à l’Université Picardie Jules Verne. Ses recherches portent sur les pratiques culturelles et les rapports de pouvoir dans les villes. Il explore ces questions à travers une diversité d’objets (musique rap, politiques publiques, festivals et événements, tourisme…), en France et dans le monde anglophone (Etats-Unis, Royaume-Uni). Il est membre du comité éditorial de la revue Urbanités et du Global Hip Hop Studies Journal, et du comité de rédaction de la revue Territoire en Mouvement.
Projets en cours
-
Patrimonialisation et mise en tourisme du hip-hop à New York : entre pérennisation artistique et changement urbain
×

Patrimonialisation et mise en tourisme du hip-hop à New York : entre pérennisation artistique et changement urbain
Financement
Programme "Métamorphoses du Patrimoine" (Alliance A2U), Université Picardie Jules Verne
Description
Né dans les années 1970 à New York, le hip-hop est un mouvement artistique et culturel qui s’est diffusé de manière large dans le monde, jusqu’à devenir l’exemple par excellence d’une culture « globale ». Au fil de sa circulation, le hip-hop a souvent manifesté un ancrage fort dans les espaces urbains locaux, et particulièrement dans les zones périphériques des grandes métropoles contemporaines (Aterianus-Owanga et Guillard, 2022). Aux Etats-Unis, en particulier, les morceaux de rap ont longtemps été présenté comme une « forme d’expression culturelle noire qui donne la parole en priorité aux voix noires des marges de l’Amérique urbaine » (Rose, 1994). Or, cette relation entre le hip-hop et les espaces urbain se voit transformée aujourd’hui dans un nouveau contexte : celui de la patrimonialisation et de la mise en tourisme de ce mouvement. Cette situation est particulièrement prégnante dans la ville d’origine du hip-hop : New York.
Depuis une décennie, la ville de New York a en effet vu l’émergence d’expositions, de circuits touristiques, de lieux d’hospitalité et d’infrastructures culturelles qui mettent en lumière l’histoire du hip-hop, en même temps que le rôle qu’il a joué dans différents espaces urbains. Prenant place dans une métropole où le tourisme constitue un secteur économique central, ces initiatives y jouent un rôle particulier : localisées dans des quartiers périphériques (le Bronx et Harlem), et mettant l’accent sur la contribution de populations longtemps marginalisées dans l’imaginaire dominant de la ville, elles font écho une volonté de certains acteurs politiques locaux de montrer New York autrement aux touristes, en les incitant à sortir de Manhattan et à s’aventurer « hors des sentiers battus » (Gravari-Barbas et Delaplace, 2015).
Pourtant, le contexte urbain dans lequel elles prennent place amènent à s’interroger sur ce grand récit. Si le Bronx et Harlem ont longtemps été associés aux classes populaires noires et hispaniques, la patrimonialisation et la mise en tourisme du hip-hop se fait à un moment où ces quartiers subissent de profondes évolutions sociales, sous l’effet d’un double phénomène de métropolisation et de gentrification. Dans ce contexte, quelle place occupent vraiment ces initiatives dans les espaces dans lesquels elles s’inscrivent ? Sont-elles un moyen de revaloriser les habitants historiques de quartiers périphériques, permettant de promouvoir un récit contre-hégémonique sur la métropole touristique (Boukhris, 2016) ? Ou participent-elles au contraire à accompagner un changement d’image de ces espaces, favorisant leur appropriation par de nouvelles catégories de population ?
Ce projet vise à répondre à ces questions à partir d’enquêtes menées à New York, combinant observations des principales initiatives patrimoniales et touristiques, entretiens avec les acteurs impliqués dans leur production et leur promotion, et analyse documentaire sur la conception et la promotion de ces projets.
Projets passés
-
L’« empreinte civique » des lieux culturels : réinventer l’évaluation de la place des théâtres dans les territoires
×
L’« empreinte civique » des lieux culturels : réinventer l’évaluation de la place des théâtres dans les territoires
Collaborateur(s)
Elizabeth Auclair et Anne Hertzog (Université Cergy Paris Université)
Financement
Direction Régionale des Affaires Culturelles d'Ile de France
Partenaires
Université Cergy Paris Université, MC93, Scène Nationale de l'Essonne
Description
Dans les dernières décennies, les politiques culturelles françaises ont été modifiées par la montée en puissance d’un nouveau référentiel : celui du « territoire ». Alors que celles-ci ont longtemps été mues par un volontarisme d’Etat et des valeurs supposées « universelles », les logiques de déconcentration et la décentralisation ont conduit à reconsidérer ces interventions publiques en lien avec les contextes locaux dans lesquels elles s’appliquent. L’inscription de « droits culturels » dans la loi NOTRe (2015) a renforcé cette dimension, en posant la question du rôle des politiques culturelles dans la lutte contre les inégalités sociales et les situations d’exclusion. Dans ce contexte, des institutions culturelles se réinterrogent sur leur place dans la ville, et inventent de nouvelles stratégies pour prendre en compte les problématiques sociales des territoires dans lesquelles elles s’inscrivent.
Cette recherche analysait ces initiatives dans deux théâtres : la Scène Nationale de l’Essonne à Evry et la MC 93 à Bobigny. Ancrés dans des communes populaires de banlieue parisienne, ces théâtres ont mis en place des actions visant à adapter leur offre et à mieux inclure les habitants. Ils sont ainsi promus par leurs directeur.rice.s comme des laboratoires pour réfléchir au rôle des structures culturelles sur un territoire, et aux nouvelles manières de les évaluer.
Effectué suite à une sollicitation des deux théâtres, ce projet avait un double objectif. Il envisageait d’une part de contribuer aux réflexions sur l’évaluation des politiques publiques, en élaborant des indicateurs qualitatifs permettant d’analyser la place de ces équipements sur leur territoire, et leur impact sur les trajectoires personnelles de différentes populations. D’autre part, ce projet apportait une réflexion sur les nouvelles formes de territorialisation des institutions culturelles en montrant comment l’action des théâtres, construite en lien avec un projet de société imaginé par les équipes des lieux, participe à l’évolution des rapports sociaux qui se tiennent localement.
Menée sur trois ans, l’enquête comportait plusieurs volets : une étude de la démarche des théâtres (année 1), grâce à des entretiens avec l’équipe des lieux ; une analyse des effets de leur action (année 2), via l’étude de plusieurs projets « participatifs » et des entretiens avec différentes catégories de publics ; des ateliers participatifs (année 3), afin de co-construire des indicateurs qualitatifs permettant d’évaluer l’action de ces institutions.
-
FESTSPACE : Festivals, Events and Inclusive Public Space in Europe
×

FESTSPACE : Festivals, Events and Inclusive Public Space in Europe
Collaborateur(s)
David McGillivray (Professeur à l’University of the West of Scotland)
Financement
Horizon 2020 (EU research and innovation programme) under The Humanities in the European Research Area (HERA) - Research program HERA Public Spaces: Culture and Integration in Europe (2019-2022)
Site
https://www.gu.se/en/research/festivals-events-and-inclusive-urban-public-spaces-in-europe-festspace
Partenaires
University of Westminster, Technological University de Dublin, Universidad Abierta de Catalunya, Gothenburg University,
Description
Si les festivals et événements se déroulent depuis longtemps dans les espaces publics des villes européennes, leur nombre et leur rôle s’est renforcé ces dernières années. Les festivals et les évènements sont de plus en plus utilisés par les autorités urbaines pour accomplir des objectifs de marketing territorial et de développement économique, en lien avec la circulation des nouveaux modèles globaux de la ville événementielle et créative. Cependant, festivals et événements jouent aussi un rôle en termes de développement et de cohésion sociale : en effet, bien que ces événements soient des phénomènes limités dans le temps, ils ont des conséquences durables sur les espaces publics, en influençant les types de populations qui les investissent, et les usages qu’ils en font.
En mettant en regard différents contextes urbains locaux, le projet européen FESTSPACE a observé la manière dont les festivals et événements favorisent ou restreignent l’accès et l’usage des espaces publics, ainsi que les échanges et les interactions entre des populations de différents milieux socio-économiques et socio-démographiques, ou de différentes origines culturelles et ethniques. Il s’est intéressé ainsi à la manière dont la conception et le fonctionnement des événements peuvent permettre de dépasser des fractures socio-spatiales existantes. Mais il a observé également la façon dont ils peuvent contribuer à renforcer l’exclusion de certaines populations, en créant des barrières symboliques, financières ou physiques qui rendent les espaces publics moins publics et moins « divers ».
Ce projet interdisciplinaire a analysé ces différents éléments principalement à travers cinq villes (Londres, Dublin, Glasgow, Barcelone, Göteborg). Leur mise en regard était justifiée par le fait que, en plus d’héberger de nombreux événements et festivals de grande ampleur, ces agglomérations connaissent actuellement de nombreuses transformations dans leur composition sociale, en lien avec d’importants phénomènes de migration et une pression touristique accrue.
Plus d’informations : https://twitter.com/festspace1
- •
- •
- •
- •
- •
- •
- •
- •
- •
- •
- •
- •
- •
- •
- •
- •
- •
- •
- •
- •
- •
- •
- •
- •
- •
- •
- •
- •
- •
- •
- •
- •
- •
- •
- •
- •
- •
- •
-
•
Rapport – Hertzog A., Auclair E., Guillard S., Cazeaux L., 2022, Etablissement d’indicateurs qualitatifs permettant de mesurer l’empreinte civique des théâtres sur leur territoire, CY Paris Université.
- •